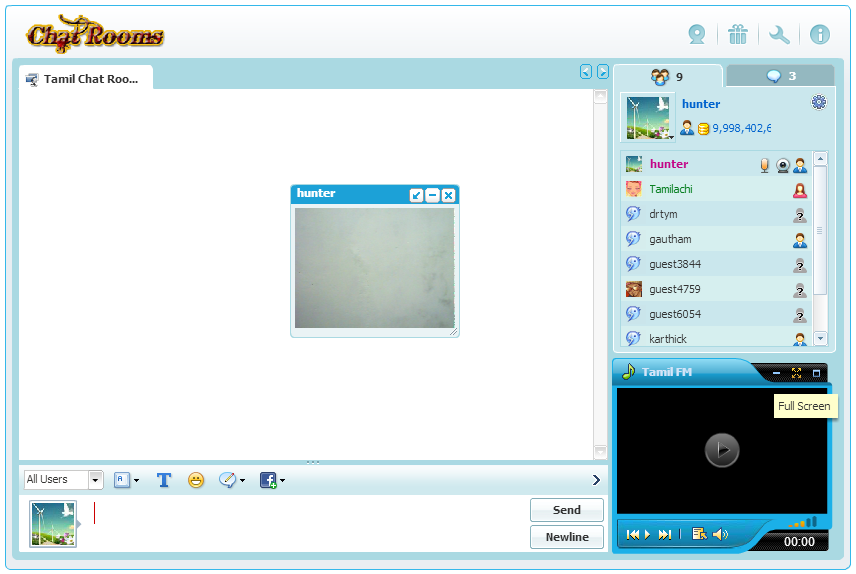Open Access Week : Les connaissances au profit de tous
Un milliard et vingt-sept millions d’euros
Un chiffre pour commencer cet article, et vous rendre compte des enjeux derrière ce concept qu’est l’Open Access. 1,027 milliards d’euros, c’est la somme qu’ont au moins dû débourser les institutions des 30 pays européens ayant répondu à l’enquête de l’EUA, l’Association des Universités Européennes, pour accéder aux ressources électroniques proposées par les maisons d’éditions scientifiques1. Et cette somme représente la limite basse, puisque tous les concernés n’ont pas répondu.
La 10ème édition de l’Open Access Week touche demain à sa fin. Semaine dédiée à l’information et à la sensibilisation sur le libre accès, les valeurs de cette mouvance née de la recherche académique médicale sont aussi celles des étudiants en médecine et de l’ANEMF. Les connaissances sont universelles et votre droit à l’information est le même que celui de n’importe qui (et a fortiori du PDG d’Elsevier-Masson, pour vous introduire le sujet).
Le libre accès est la mise à disposition en ligne gratuitement de contenus numériques. L’appellation, et le mouvement plus généralement, concernent surtout les articles issus de la recherche académique, et donc financés par l’argent public.
Pourquoi le libre accès aux publications scientifiques est indispensable pour notre système de santé ? Quelles sont les actions entreprises en France et dans le monde pour offrir la science à tous, puisqu’elle n’appartient à personne ?
Libre accès : pourquoi ?
Parce qu’après tout, pourquoi faire tant de bruits pour des articles ultra-spécialisés qui n’intéressent que quelques personnes autour du globe, et qui de surcroît ont toujours été capables de les acheter sans se plaindre ?
Rien de tout cela n’est vrai en réalité.
Comme rappelé au-dessus, les produits de la recherche académique sont issus de financements publics. Il paraît naturel que chacun des contributeurs, c’est-à-dire les citoyens, ait accès aux résultats qu’il a contribué à obtenir. Outre cette vision d’un retour à l’investisseur, nous avons d’autres raisons de défendre un accès libre aux données de la science.
Nous sommes dans un contexte où des liens d’intérêt sont prouvés responsables de scandales sanitaires, entraînant une remise en question constante des résultats de la science et une présupposition constante de l’influence de lobbys dédiée au profit (#BigPharma). Le mouvement anti-vaccins ou le développement des fakemeds (voir notre dossier de presse) sont des exemples flagrants de situations problématiques pour la santé publique. Un accès ouvert et facilité aux articles de recherche permettrait de restaurer une confiance dans le processus scientifique et, au besoin, de vérifier la littérature ainsi disponible. Cela s’intègre parfaitement dans la perspective d’une démocratie sanitaire, associant tous les acteurs du système de santé dans l’élaboration des politiques publiques : impossible sans accès à l’information pour chacun de ces acteurs.
Nous sommes destinés à devenir des professionnels de santé, soumis à un devoir de formation continue pour pouvoir soigner et guérir nos patients aussi bien que l’état de l’art le permet. Pouvons-nous respecter ce devoir si nous n’avons pas les moyens d’avoir accès aux articles rapportant les améliorations des protocoles de soins existants, les études cliniques innovantes, etc. ?
Nous sommes des étudiants, et nos supports de cours évoluent très rapidement. Sans se limiter aux études de médecine (et notre fameux référentiel unique), de nombreux domaines d’études demandent un accès récurrent aux articles de recherche les plus récents. L’argent investi par les universités, qui se chiffre en millions, pour donner accès à ces articles aux étudiants pourrait être utilisé pour bien d’autres choses si les articles étaient comme ils pourraient l’être : libres et gratuits.
Nous sommes enfin dans un pays développé, qui a la chance de pouvoir payer l’accès à ces articles pour ses étudiants et ses professionnels. Ce n’est pas le cas de la majorité des pays du monde. Il existe une véritable inégalité limitant le développement des pays émergents qui ne peuvent investir dans la recherche ou la santé dû à ces frais nécessaires, mais impayables.
![]()
Avantages du libre accès²
Libre accès : quoi ?
Droit gratuit, irrévocable, mondial, d’accéder à l’oeuvre, … à la copier, l’utiliser, la distribuer, la transmettre et la montrer en public … sous réserve d’en mentionner comme il se doit son auteur.
Déclaration de Berlin sur le Libre Accès à la Connaissance en Sciences Exactes, Sciences de la vie, Sciences humaines et sociales, 2003
|
Aujourd’hui la majorité des articles de la recherche française sont encore en accès fermé, c’est-à-dire qu’il est nécessaire de payer des sommes faramineuses à des maisons d’éditions scientifiques pour y avoir accès. Ces articles, payés à l’unité (jusqu’à plusieurs dizaines d’euros par article) ou via un abonnement (les contrats sont confidentiels mais les sommes avancées se chiffrent en millions3 par structure) sont indispensables aux travaux des chercheurs mais aussi à la pratique clinique des médecins. Un chercheur se base continuellement sur l’état de l’art pour ses propres recherches; un médecin doit en permanence se tenir au courant des nouvelles données de la science pour soigner au mieux.
Les résultats présentés dans ces articles sont financés en grande partie par l’argent public : des bourses d’agences gouvernementales françaises, des universités ou des institutions de recherche, de la Commission Européenne, etc. Non contents de faire payer l’accès aux articles, les éditeurs font payer les chercheurs pour qu’ils voient leurs travaux publiés. Non contents de faire payer l’accès et la publication, les éditeurs font travailler bénévolement les chercheurs pour assurer la qualité des articles, dans le processus de revue par les pairs. Les chercheurs n’ont pas vraiment le choix, sous peine de se mettre à dos les éditeurs s’ils refusent trop.
Les chercheurs se doivent donc de publier, premièrement pour faire connaître à la communauté scientifique leurs résultats, deuxièmement car le fait de publier et les journaux où ils publient sont le principal (pour ne pas dire quasi seul) moyen d’évaluer l’activité de recherche en France aujourd’hui.
Pour les institutions de recherche, l’accès aux articles et leur écriture sont donc indispensables. Le système actuel de l’édition scientifique fait passer ces deux mécanismes par les maisons d’éditions, qui sont bien conscientes du pouvoir qu’elles possèdent ainsi. Le système dans son ensemble permet une prise en otage des chercheurs et des institutions.
Pour les articles seulement, les maisons d’éditions engrangent 726 millions d’euros en Europe, chiffre sujet à une augmentation de 3,6% par an4, et encore une fois c’est une limite basse.
![]()
Financement de la recherche et de la publication5
Avant de passer à une partie plus technique, qui pourrait ne pas vous intéresser, voici une initiative lancée par des mathématiciens de boycott individuel contre les pratiques d’Elsevier en terme de tarifications de leurs journaux : The Cost of Knowledge6. Vous pourrez signifier, entre autres, ne pas vouloir publier dans un de leur journaux en allant sur leur site www.thecostofknowledge.com.
Libre accès : comment ?
Gold or Green : les couleurs de l’Open Access
Le libre accès se sépare en deux grandes catégories aujourd’hui, selon le mode de mise à disposition des articles.
- La voie verte : les chercheurs mettent en accès libre leurs articles sur des sites d’archivage après les avoir publiés dans un journal. La plateforme française est HAL. Cette option n’est pas la plus aisée du fait que le producteur du contenu doit lui-même aller déposer son oeuvre sur le site. On notera les efforts qui sont faits par les bibliothèques universitaires pour aider les chercheurs s’ils le demandent.
- La voie dorée : le journal propose l’article en accès libre, sans avoir à l’acheter. Cette option est aujourd’hui souvent encore payante pour les équipes de recherches qui paient des Article Processing Charges (frais de publication) importants, en sus de ceux de base, pour que leur article soit en libre accès7.
Renverser le monopole de l’édition, des initiatives à toutes les échelles
Une fois n’est pas coutume, les médecins sont à l’origine de ce mouvement. La World Medical Association (Association Médicale Mondiale) a adopté en 1964 à Helsinki sa déclaration sur les “Principes éthiques applicables à la recherche impliquant les êtres humains” :
| Les chercheurs, auteurs, promoteurs, rédacteurs et éditeurs ont tous des obligations éthiques concernant la publication et la dissémination des résultats de la recherche. Les chercheurs ont le devoir de mettre à la disposition du public les résultats de leurs recherches impliquant des êtres humains. Toutes les parties ont la responsabilité de fournir des rapports complets et précis. Ils devraient se conformer aux directives acceptées en matière d’éthique pour la rédaction de rapports. Les résultats aussi bien négatifs et non concluants que positifs doivent être publiés ou rendus publics par un autre moyen. La publication doit mentionner les sources de financement, les affiliations institutionnelles et les conflits d’intérêts. Les rapports de recherche non conformes aux principes de la présente Déclaration ne devraient pas être acceptés pour publication. |
Article 3
Depuis plus de 50 ans, le mouvement s’est développé et un grand nombre d’initiatives remarquables sont à noter.
SPARC (Scholarly Publishing and Academic Ressources Coalition)
Fédérant plus de 800 institutions à travers le monde, et surtout aux Etats-Unis et Canada, SPARC est une coalition donnant les moyens à ses adhérents d’informer sur les enjeux de l’Open Access mais également de l’Open Data et de l’Open Educational Ressources. Son antenne européenne est SPARC Europe.
Right To Research
Fédération créée par des anciens de l’IFMSA, la Fédération Internationale des Associations des Étudiants en Médecine, ce réseau représente aujourd’hui plus de 7 millions d’étudiants. Elle produit des supports d’informations, interagit avec les autres acteurs du domaine et est une source de personnes motivées sur le sujet.
European University Association
L’association des universités européennes est l’équivalent de notre Conférence des Présidents d’Université. Très attachée au libre accès des articles, étant responsable de l’immense majorité des équipes de recherches en Europe (et donc de leur finance aussi), elle publie depuis quelques années un rapport annuel sur les Big Deals, ces contrats confidentiels entre les universités et les éditeurs pour donner accès aux articles aux chercheurs.
Ces rapports, en anglais, sont très intéressants pour mieux comprendre la réalité de la situation !
La cOAlition S et son Plan S
Lancée par Science Europe, une association regroupant des organismes financeurs de la recherche8 et des organismes “producteurs” de recherche9, la cOAlition S10 est internationale et est soutenue par la Commission Européenne et le Conseil Européen de la Recherche.
Elle a lancé le Plan S en Septembre 2018, stipulant que dès 2021 tous les articles de recherche financés par les organismes adhérents devront être en accès libre. Le Plan S insiste sur le droit d’auteur conservé par les auteurs, l’application d’un plafond aux frais de publication, ou encore l’importance des archives et dépôts ouverts, tel que HAL chez nous.
Elle est critiquée par les éditeurs scientifiques et certains chercheurs sur un point précis : l’incompatibilité, énoncée explicitement, des “revues hybrides” avec le Plan. Ces journaux proposent du libre accès doré et de l’accès fermé en même temps. Si les critiques des éditeurs sont compréhensibles étant donné leur intérêt financier, les réticences des chercheurs sont liées à l’impossibilité de publier dans ces revues après 2021 malgré leur reconnaissance en terme de qualité de la recherche. C’est un problème réel mais qui n’est en réalité qu’un symptôme d’un problème presque aussi important : la mauvaise évaluation des travaux de recherche, qui se base plus sur le journal où l’article est publié que sur le contenu lui-même.
Vous pouvez retrouver les principes du Plan S sur leur site.
Plan National pour la Science Ouverte
Après une première étape avec la loi pour une République Numérique, votée en 2016 et instituant le droit à utiliser la voie verte pour tous les travaux financés publiquement à plus de 50% quels que soient les accords passés avec les éditeurs, le gouvernement français s’est doté d’un plan assez ambitieux pour la Science Ouverte et qui comporte donc tout un volet sur le libre accès. Allant plus loin que la loi de 2016, le libre accès devient obligatoire pour les articles français financés publiquement. Le Plan National pour la Science Ouverte comporte beaucoup d’autres aspects visant à développer la science ouverte en général, dans un contexte international et sur tous les pans de la recherche.
Nouveaux moyens de publication
Si tous les grands éditeurs ont fait des efforts pour proposer des services de libre accès, le paradigme de la publication changeant avec ou sans eux, des innovations sont à noter du côté du système de publication en lui-même.
Initiés en 1991 avec ArXiv, les serveurs de pre-prints ont pris beaucoup d’importance ces dernières années. Un pre-print est un manuscrit d’article qui est mis en ligne, en accès libre, par ses auteurs sans que celui-ci n’ait passé l’étape du peer-reviewing, classiquement gérée par les journaux avant la publication11. L’utilisation de plus en plus importante de ces serveurs remet en question la façon dont la communauté scientifique évalue la recherche, ne pouvant plus utiliser les métriques classiques des journaux pour évaluer rapidement (mais médiocrement) la qualité d’un article. Elles peuvent également compliquer la lecture des articles par des non-spécialistes des sujets qui ne peuvent de facto pas eux-mêmes évaluer la rigueur d’un travail scientifique (vulgarisateurs scientifiques, gens lambda, patients, etc.). Des serveurs spécifiques à la biologie, BioRxiv, ou à la médecine, MedRxiv, existent, financés ici par Cold Spring Harbor Laboratories.
Pour toujours plus d’informations, je vous invite à aller voir le site internet de l’Open Access Week, le Dossier de Presse de l’ANEMF sur le sujet ou à vous tourner vers votre Bureau National pour des questions spécifiques (mail, messenger, etc.).
La science n’appartient à personne, alors offrons la à tout le monde !
1 : Rapport Big Deals 2019 de l’EUA
2 : Communication de l’IFMSA
3 : Rapport Big Deals 2019 de l’European University Association
4 : Rapport Big Deals 2019 de l’EUA
5 : Tirée du DP de l’ANEMF 2018 “Recherche, entre progrès et profit”
6 : Le Prix de la Connaissance pour les non anglophones ![😉]()
7 : Dépend des domaines de recherches, mais la biologie et la médecine n’ont que très peu de revues gratuites pour la publication et l’accès
8 : C’est-à-dire qui décernent des bourses de recherche (de quelques dizaines de milliers d’euros à plusieurs millions) à des équipes pour leurs projets. La France compte son Agence Nationale de la Recherche parmi les membres
9 : En France ce pourrait être l’INSERM ou le CNRS, qui n’en font pas partie néanmoins.
10 : cOAlition S : remarquez les majuscules qui forment … Open Access.
11 : L’étape où les chercheurs travaillent bénévolement pour relire les articles, vous vous souvenez ? ![😉]()